Le refus scolaire anxieux (RSA), anciennement appelé phobie scolaire, représente bien plus qu'une simple réticence à aller en classe. Il s'agit d'un véritable trouble anxieux qui empêche physiquement et psychiquement l'enfant ou l'adolescent de se rendre à l'école, malgré tous les efforts déployés par la famille et les équipes éducatives.
Définition et ampleur du phénomène
Le refus scolaire anxieux concernerait entre 1 et 2 % des élèves, de la maternelle au lycée, dans de nombreux pays, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cependant, un phénomène sans doute sous-estimé en France, faute d'indicateur précis, et surtout mal caractérisé.
Les données françaises restent parcellaires car l'Éducation nationale ne mesure que l'absentéisme, à partir de quatre demi-journées d'absence non justifiées par mois, ce qui mélange différentes situations d'absence sans distinguer le refus scolaire anxieux des autres formes d'absentéisme.
Une étude récente menée par l'Inserm sur 2 000 questionnaires recueillis a permis d'identifier 1 328 dossiers répondant à la définition du RSA, révélant l'ampleur méconnue de ce trouble. Plus alarmant encore, une étude américaine a montré que 25% des élèves seraient un jour touchés, de manière plus ou moins forte et durable, par des épisodes de troubles anxieux scolaires au cours de leur scolarité.

Les origines multiples du refus scolaire anxieux
Un trouble plurifactoriel complexe
Le refus scolaire anxieux ne découle jamais d'une cause unique. 80 % des jeunes atteints de refus scolaires anxieux (RSA) présentent au moins un trouble anxieux tel que défini par le DSM 5, anxiété de séparation majoritaire jusqu'à la sixième et anxiété sociale chez l'ado. Un épisode dépressif – lié à l'épuisement des efforts faits pour surmonter ses angoisses – et une faible estime de soi sont retrouvés dans 52% des cas.
Les facteurs déclenchants
Dans les enquêtes dédiées, enfants et parents déclarent un facteur déclenchant dans 4 cas sur 5, mais il existe une grande disparité dans la nature de cet évènement. Parmi les déclencheurs les plus fréquents :
Facteurs scolaires : critique d'un enseignant, impression d'avoir été ridiculisé, pression liée aux résultats, changement d'établissement
Facteurs relationnels : sur les 1 328 élèves souffrant de refus scolaire anxieux, près de la moitié ont été victimes de harcèlement, d'insultes ou de menaces
Facteurs personnels : difficultés d'apprentissage (dyslexie, dysgraphie), le handicap, la précocité, ou les troubles autistiques
Facteurs familiaux : maladie, décès, déménagement, séparation des parents
L'impact de la pandémie de Covid-19
Mis en lumière par l'épidémie de Covid qui a grandement perturbé la scolarité des enfants, le refus scolaire anxieux n'est pourtant pas nouveau. La crise sanitaire a cependant considérablement aggravé la situation. Le sentiment d'augmentation des refus scolaires anxieux est objectivé par l'augmentation des demandes de dispositifs alternatifs à la scolarité pour les élèves totalement ou partiellement déscolarisés depuis 2019-20.
Manifestations cliniques : un trouble polymorphe
Selon l'âge de l'enfant
Chez les plus jeunes (primaire) : les absences sont souvent liées soit à des symptômes somatiques (maux de ventre, maux de tête…), soit à un problème médical, rare ou chronique, qui s'aggrave pendant la période considérée.
Chez les adolescents : Les adolescents de l'étude ont plutôt développé un refus scolaire vers 11–12 ans, en lien avec différents troubles (dépression, phobie sociale) ou questions (identité de genre) ou encore un environnement scolaire dont ils se plaignent.
Les critères de Berg pour le diagnostic
Pour poser le diagnostic de refus scolaire anxieux, les professionnels s'appuient sur les cinq critères de Berg :
- Refus d'aller à l'école conduisant à une absence prolongée
- Détresse émotionnelle sévère (anxiété, colères, dépression) liée à la fréquentation scolaire
- L'enfant reste à la maison avec l'accord des parents (pas de conduite antisociale)
- Absence de trouble de conduite significatif
- Efforts significatifs des parents pour pousser l'enfant à fréquenter l'école
Profil type des jeunes concernés
Les quelques données françaises concernant les adolescents en situation de refus scolaire anxieux montrent qu'il s'agit surtout de filles, généralement de bons élèves de milieu plutôt favorisé avec des parents stressés par la scolarité et demandeurs de solutions. Mais tout enfant, un jour, peut souffrir du Refus Scolaire Anxieux !
On note deux périodes de la vie qui représente des pics de fréquence : 10-11 ans, ce qui correspond en France à l'entrée au collège, et 13-15 ans, qui est la période classique de début des troubles anxieux.

Prise en charge pour les parents : stratégies d'accompagnement
Le repérage précoce : clé du succès
La repérer tôt – dans les 3 à 4 semaines après déscolarisation totale – permet d'intervenir efficacement et de modifier le devenir des jeunes. Les signaux d'alarme à surveiller incluent :
- Petits maux récurrents avant d'aller à l'école (maux de ventre, maux de tête)
- Changement brutal de comportement
- Passages fréquents à l'infirmerie
- Isolement dans la cour de récréation
- Diminution progressive de l'assiduité
- Situations de harcèlement décrites par l'enfant
Éviter la déscolarisation complète
L'objectif étant d'éviter au maximum la déscolarisation. Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place :
Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) : permet des aménagements personnalisés au sein de l'établissement
L'APADHE : Assistance Pédagogique À Domicile, à l'Hôpital ou à l'École, pour maintenir un lien scolaire adapté
L'instruction en famille : solution temporaire qui doit rester exceptionnelle
Le CNED : à réserver aux cas les plus sévères pour éviter la désocialisation
Accompagnement familial
Les parents jouent un rôle crucial dans le processus de guérison :
- Maintenir un rythme de vie régulier : sommeil, repas, activités
- Préserver l'estime de soi de l'enfant : éviter les reproches ou la culpabilisation
- Collaborer étroitement avec les professionnels : médecins, psychologues, équipe éducative
- Accepter temporairement la non-scolarisation : pour permettre à l'enfant de se reconstruire psychiquement (demander à votre médecin généraliste 15 jours d'arrêt d'école en faisant un certificat).

Approches thérapeutiques efficaces
La thérapie cognitive et comportementale (TCC)
La thérapie cognitive et comportementale (TCC) est aujourd'hui l'approche la plus intéressante pour favoriser la rescolarisation rapide et durable. Cette approche comprend :
- Techniques de gestion du stress : relaxation, respiration, exposition progressive
- Travail cognitif : traitement des pensées anxieuses liées aux situations scolaires
- Thérapie individuelle et de groupe : pour développer les compétences sociales
Hospitalisation de jour
Depuis une quinzaine d'années, une unité du CHU de Montpellier (située dans l'hôpital La Colombière) prend en charge des collégiens et lycéens souffrant de refus scolaire anxieux. Ces patients bénéficient d'une hospitalisation de jour à raison de 3 à 4 demi-journées par semaine pendant plusieurs mois.
Conseils pratiques pour les enseignants
Repérage et signalement
Les enseignants sont souvent les premiers à observer les signaux d'alarme. Leur rôle est essentiel pour :
- Observer les changements comportementaux : baisse soudaine de participation, isolement, anxiété visible
- Noter les absences répétées : particulièrement celles liées à des "malaises" récurrents
- Communiquer avec l'équipe : informer le CPE, l'infirmière scolaire, la direction
- Alerter les parents : sans dramatiser mais en exprimant leurs préoccupations
Adaptations pédagogiques
En classe :
- Éviter de mettre l'élève en situation d'évaluation surprise
- Proposer des alternatives aux présentations orales si l'anxiété sociale est présente
- Permettre des pauses ou des sorties temporaires en cas de crise d'angoisse
- Valoriser les réussites, même petites, pour restaurer l'estime de soi
Lors du retour progressif :
- Commencer par des demi-journées ou quelques heures
- Identifier les moments/matières les moins anxiogènes pour l'élève
- Prévoir un référent adulte vers qui l'élève peut se tourner
- Éviter de rattraper immédiatement tout le retard accumulé
Communication bienveillante
- Éviter les jugements : ne pas considérer l'absence comme un caprice
- Maintenir le lien : continuer à inclure l'élève dans les projets de classe
- Rassurer sur l'accueil : garantir un retour sans stigmatisation
- Collaborer avec les parents : partager les observations sans culpabiliser

Pronostic et évolution
Facteurs pronostics
Chez les élèves d'âge primaire, le retour à l'école se fait en général au bout de deux ans de suivi. Pour les adolescents, l'évolution est plus variable : Certains se rétablissent, lentement, grâce à un accompagnement a minima hebdomadaire. Mais pour beaucoup, la situation se dégrade, plus ou moins vite, jusqu'à une déscolarisation complète malgré des aménagements scolaires et un suivi médical lourd.
L'importance d'une prise en charge précoce
Plus ils sont pris et reconnus tôt (moins de 3 mois après les premiers signes), moins les troubles anxieux scolaires seront longs à soigner. Le succès de la prise en charge repose sur un partenariat entre la famille, les équipes éducatives et les thérapeutes, avec un accompagnement et un investissement conjoint dans les trois sphères de vie de l'enfant (foyer, école, soins), autour de son bien-être et de ses besoins.
Perspectives d'avenir
Le refus scolaire anxieux nécessite une reconnaissance institutionnelle plus forte. La Dre Denis a évoqué une pathologie peu reconnue qui mériterait d'être mieux référencée par les classifications internationales.
La formation des équipes éducatives, la sensibilisation des parents et le développement de dispositifs de prise en charge adaptés constituent les enjeux majeurs pour accompagner efficacement les enfants et adolescents concernés.
Au-delà de la variété des causes, des manifestations et du niveau de gravité, ce qui ressort c'est que dans tous les cas, la phobie scolaire n'est pas un caprice ou un simple passage à vide que l'enfant peut surmonter moyennant quelques efforts. Cette réalité doit être pleinement intégrée par tous les acteurs pour proposer des réponses adaptées et bienveillantes à ces jeunes en souffrance.
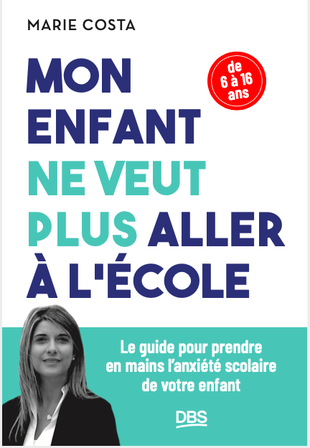
Une ressource indispensable pour comprendre
Pour accompagner parents et professionnels dans cette démarche complexe, l'ouvrage de Marie Costa "Mon enfant ne veut plus aller à l'école" publié chez DBS offre un éclairage précieux.
Ce guide pratique, fruit de l'expérience de l'auteure en tant que coach parentale, et d'une étude portant sur plus de 500 familles, propose des stratégies concrètes pour comprendre les mécanismes du refus scolaire anxieux et accompagner l'enfant vers un retour serein à l'école.
Marie Costa y aborde les questions que se posent tous les parents confrontés à cette situation : comment réagir face au refus, comment maintenir le lien avec l'école, comment préserver la relation parent-enfant tout en cherchant des solutions. Son approche bienveillante et pragmatique en fait un outil indispensable pour naviguer dans cette épreuve familiale.

Écrire commentaire